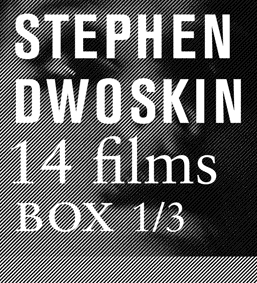 |
commandez le coffret informations sur les dvd |
"Mon cinéma est beaucoup mieux adapté à la vision d'un seul spectateur.
Je prends les spectateurs un à un, ce qui est l'inverse du cinéma
hollywoodien qui a pour principe d'amalgamer le public."
Stephen Dwoskin
| François Albera : | Stephen Dwoskin |
| Stephen Dwoskin, une poétique de l’« empêchement » |
|
| Steve Dwoskin : DV on SKIN | |
| Cathy Day : | Je filme donc nous sommes |
| Michel Barthelemy : | A propos de quatre films de Stephen Dwoskin |
Stephen Dwoskin
Né à New York en 1939, plus précisément à Brooklyn dans une famille
modeste venue d’Odessa, Steve Dwoskin contracte la poliomyélite
à l’âge de 7 ans et demeure invalide. Il suit des études artistiques
(avec de Kooning et Albers comme professeurs), puis la New York
University et la Parsons School of Design. Il fréquente les milieux
de Greenwich Village, notamment Andy Warhol, Allen Ginsberg,
Robert Frank, découvre le cinéma expérimental avec Maya Deren.
Les films « underground » transgressifs de Jack Smith et Ron Rice
le marquent. Il publiera plus tard un livre sur ce cinéma, écrit de
manière toute personnelle, un témoignage engagé, film is… A cette
époque, rappelons que la police américaine procédait à des
« descentes » dans certains lieux où l’on projetait les films
expérimentaux et qu’elle saisissait et détruisait les copies, arrêtait
les organisateurs, cinéastes et quelquefois spectateurs, sur le modèle
de la Prohibition ! Ce cinéma inadmissible pour ne pas passer par les
standards et les canaux commerciaux était alors taxé de
« pornographique ».
Après avoir exercé des activités de photographe et de graphiste,
Dwoskin travaille pour CBS comme art director tout en réalisant
des films personnels avec de la pellicule récupérée. Le premier
d’entre eux, Asleep, remporte un prix à la Biennale de Venise.
En 1964, il bénéficie d’une bourse pour se rendre en Grande Bretagne
où il s’installe et impulse un courant de cinéma indépendant
(la London Film-Makers’ Cooperative). Dans les années 1970,
il tourne des longs-métrages qui le font reconnaître au-delà du
mouvement expérimental et soutenir par des institutions et des
chaînes de télévision culturelles (en particulier la ZDF allemande).
Après une période consacrée à des documentaires subjectifs sur des
artistes, comme le photographe Bill Brandt ou le phénomène des
Ballets nègres, son cinéma s’infléchit vers le journal intime à mesure
que sa mobilité se réduit.
Dans cette œuvre, la division entre New York et Londres au plan
géographique se double donc d’une division entre une période
expérimentale proprement dite (jeu sur les constituants filmiques,
le cadre et le hors-champ, la durée, la répétition) et une période plus
complexe du point de vue dramaturgique et narratif.
Mais toute son œuvre est une exploration de la problématique du
voyeurisme, du rapport à l’autre que cet homme-caméra tente
d’approcher ou de s’approprier en dépit de son immobilité, développant
toute une dimension tactile du regard. Ainsi Dyn-Amo, qui filme le
spectacle théâtral d’une scène de strip-tease minable où deux jeunes
femmes se font maltraiter par un gigolo en un cruel et lancinant rituel
sado-masochiste. La caméra promène sur la scène un regard sans cesse
en défaut, qui rate, décadre, fragmente, jusqu’à fixer avec insistance,
au-delà du jeu, du maquillage, le désarroi de l’actrice dès lors mise à nu
tout autrement que dans son corps. La fixité, l’obstination de ce plan font
se retourner le regard de la « victime » vers le spectateur constitué
lui-même en sadique. Tous ses premiers films (Alone, Trixi, Moment,
Times For) effectuent une subtile déconstruction du système
conventionnel du regard masculin que les genders studies aborderont
plus tard au sein du cinéma dit « classique » : c’est d’ailleurs à partir
d’une réflexion sur Dwoskin (dont elle était proche à Londres) que
Laura Mulvey développa les bases de cette approche en un texte
devenu la référence obligée des études « genres ».
Sans rien oublier de ses premières expériences limites, Dwoskin tourne
ensuite des fictions, y compris une magnifique adaptation de Wedekind,
Tod und Teufel où l’espace intersticiel, les faux-mouvements sont filmés
pendant des actes de paroles, plutôt que les personnages et leurs faits
et gestes. Inspirés par la lecture d’Erwin Goffmann, plusieurs films
prennent la claustration pour condition, en observent les effets sur les
reclus, en particulier les stratégies de mise en scène de soi, de séduction,
les rapports de force (Central Bazaar); dans quelques cas, Dwoskin met
lui-même en scène son corps d’invalide (Behindert) ou consacre tout
un film aux déréglements qu’induit le handicap dans une société
normalisée, poussant leurs conséquences jusqu’au burlesque (Outside In).
Sa proximité avec le surréalisme (Aragon, Georges Bataille) et ses
précurseurs (Jarry, Carroll) nourrit son approche de l’érotisme dans
ses films des années 1980 (Shadows from Light sur la photo de
Bill Brandt, Further and Particular d’après Ma Mère de Bataille et le
Dr Faustroll de Jarry). Après des films sur la peur et la douleur puis la
mémoire et l’enfance utilisant des films de famille où on le voit, enfant,
gambader (Trying to Kiss the Moon), il renoue avec l’expérimentation
grâce à la caméra numérique et l’ordinateur qu’il peut utiliser depuis
son lit d’hôpital. Ce journal intime adopte le régime narratif du
monologue intérieur qui permet de mêler à la situation de l’énonciateur
de plus en plus difficile (hospitalisations, assistance respiratoire),
fantasmes et rencontres aléatoires de visiteurs ou de soignants, dérives,
collages et réminiscences.
François Albera
Paru dans la revue Zeuxis (France) Juin 2004 avec l'aimable autorisation
de l'auteur ©François Albera
(retour au menu)
Stephen Dwoskin, une poétique de l’« empêchement »
Le cinéma de Dwoskin des années 60-70, parce qu’il est celui d’un
homme-caméra, un regard appareillé, et que cet homme, ce regard,
est empêché (behindert), non pas comme le veulent les expressions
lénifiantes du soft-social, « à mobilité réduite » mais carrément planté
au sol sur des béquilles ou cloué au lit ou reclus dans un coin, sur
une chaise ou un fauteuil (fût-il roulant), ce cinéma touche à l’essentiel
de ce qu’est une caméra de cinéma : figée, pesante, malhabile, borgne,
bornée, peu sensible à la lumière. Dans ses premiers films (notamment
Asleep, Alone, Naissant, Soliloquy, Take Me, Moment, Trixi,
Jesus Blood…), il s’agit souvent d’une stratégie de « coup », comme
on tente un coup aux échecs (d’ailleurs : Chinese Checkers), un parti pris,
disons minimaliste, une restriction qui doit susciter un maximum d’effet
en face. Un rapport de force. La personne filmée est collée au mur, cloué
sur son lit, traquée et ce dispositif coercitif, lancinant se déploie ou se
creuse par le montage, le zoom, la répétition, le ralenti. Le sujet ainsi
pris au piège du regard, craque, jouit, lâche, frise l’anéantissement.
Dans Dyn Amo (mais aussi Me Myself and I) cependant, on voit bien que
celui qui filme ainsi, s’il exerce cette violence du regard n’est cependant
pas dans une position de maîtrise. Au cœur de ce rapport qui semble de
corps à corps mais n’est que regard empêché, surgit un espace
d’évitement, de ratage, de dérapage. Et puis, si l’on prend par décision
démonstrative et par choix d’élection Tod und Teufel comme film-pivot,
ce cinéma semble déplacer son objet sur ce « ratage » justement,
il tourne autour des sujets filmés s’intéresse aux interstices, à l’espace
entre les gens, l’air, à filmer la peau, le geste esquissé et retenu,
le cillement d’une paupière, le frémissement d’une narine, un
tremblement. Enfin, grâce à l’allègement continu de l’appareil désormais
appendice de la main, caméra-stylo, — et non stylo de l’écrivain par
lequel Astruc croyait libérer le cinéma, mais le « style » de Marey qui
traduit les moindres réactions du sujet, de l’animal et les inscrit sur le
cylindre de papier millimétré) —, la caméra se délie, danse et caresse
ses sujets. Alors commence une exploration qui confond le grain de la
peau et celui de la bande video ou du disque numérique, pores et pixels.
Le peintre Dwoskin retrouve l’épaisseur de la matière sur son ordinateur,
il superpose les couches d’images, les mêle, revient en des repentirs
qui sont des aveux sensuels.
Revenons à la première époque ainsi dénommé par commodité de
présentation car bien sûr ce qu’on a, en ces trois moments, désigné doit
être plutôt abordé en tant que « dominante ». Ces entraves à
l’omnipotence et à l’omnivoyance que pourtant ceux qui parlent de
cinéma nient pour en appeler à « toujours plus » d’ubiquité, de mobilité,
de légèreté, un cinéma « total » voire même plus de cinéma du tout,
confondu avec la réalité, elles sont pour d’autres constitutives du
regard filmique. Edison, dit Sadoul à de multiples reprises, a
« lourdement fixé au plancher de la Black Maria », « voiture cellulaire »,
la caméra, elle est empesée. Méliès, l’a-t-on assez dit, filme
frontalement la scène du théâtre Robert-Houdin, « du point de vue
du Monsieur de l’orchestre ». Après lui, après eux, grâce au montage,
grâce au découpage, cette caméra s’envolera « sur un tapis volant »,
elle soulèvera les toits comme Asmodée, elle s’insinuera partout,
omnisciente. D’autres, comme Arnheim, ont érigé les entraves en bases
constructives de la démarche artistique : puisque l’angle me limite,
la planéité de l’image aplatit, la focale déforme, la lumière simplifie le
réel perçu, l’art comblera ces manques, suppléera ces handicaps de
l’appareil par la suggestion du hors champ, la composition du cadre,
l’arrangement savant des ombres et des lumières.
On voit bien que le handicapé Dwoskin, entêté à tenir lui-même sa
caméra alors qu’il doit caler sous ses bras deux béquilles tout droit
sorties d’une gravure de Callot, qu’il doit assurer les courroies et les
jambières de chevalier médiéval qui lui enserrent ses jambes sans force,
on voit bien que ce cinéaste-là pourrait correspondre et au modèle de
cette caméra entravée et à cet artiste empêché de tout saisir et qui
creuse la portion de visible pour en développer la métonymie du tout,
projetant de la sorte un monde « construit ». Les sémiologues ont
postulé, en effet, que pour qu’il y ait « diégétisation », il fallait qu’il y
ait construction d’un monde, effacement du support et création d’un
espace habitable par un personnage. Tous les procédés de
« suppléance » que l’on mobilise (du découpage au montage, du
mouvement d’appareil à l’éclairage, aux trucages même) vont en ce
sens. Quelque invraisemblable que soit le monde construit (dinosaure,
martien, parrain, gladiateur, agent secret) il s’agirait d’un monde
habitable par l’homme et d’un monde possible ! Plaisants humoristes
que les sémiologues… Dwoskin fait exactement l’inverse : il explore
l’inhabitabilité du monde, par lui à qui toutes les commodités sont
refusées (même de s’asseoir comme l’y invite telle bonne âme
insouciante) mais aussi bien par tous — il en aura perçu l’hostilité
avant les autres — et, à l’intérieur de cette hostilité, de ce refus,
de cette clôture, il creuse les interstices de la survie, les échappées
de l’imaginaire, les attentions minuscules à des détails, des
mouvements amorcés. Habiter ce monde inhabitable, comprendre
que cela passe par les sensations que procurent l’épaisseur du support,
la matière même de ce qui fait médiation entre lui et les autres, lui
et ce monde justement, non pas un monde construit par lui (le fameux
univers romanesque de l’écrivain) mais ce monde-là, auquel se confronter
désespérément puisqu’il n’y a que lui et dont les couches, les replis
recèlent sans doute les conditions de la survie : sensualité, désir,
jouissance, étonnement, ravissement.
François Albera
Texte du livret du coffret 5DVD ©les films du renard/François Albera
(retour au menu)
Steve Dwoskin : DV on SKIN
Dans sa plus récente période le cinéma de Dwoskin offre un nouveau type
d’image: une image-geste. On peut la repérer dès le filmage où la légèreté
de la caméra dv qu’on tient à bout de bras ou de doigt, permet une
mobilité de pinceau. Affranchis de tout cadre narratif, les derniers films
(Some Friends, Lost Dreams, Dad, Dear Frances) offrent ainsi au spectateur
une envoûtante suite de variations sur des visages, des objets, des lieux,
des ébauches d’actes. La caméra balaie, reprend comme le peintre repasse
sa brosse sur la même portion de toile, épaississant ou au contraire étalant
la couleur, la mélangeant à une autre, recouvrant une figure. A la différence
que chez Dwoskin, puisqu’on est dans la forme temporelle du film, ces
retouches ou ces repentirs sont successifs, ils s’enchaînent et ne disparaissent
pas sous la dernière «couche». En d’autres termes, l’immédiateté qui nous
est transmise par cette caméra tactile se complique en se projetant dans le
déroulement du film lequel nous donne à voir toutes ses phases, nous montre
ses dessous. Ce n’est pas du tout qu’on voie l’image finale «se faisant»
(comme dans Matisse peint ou le Mystère Picasso) : on étale dans le temps
les variations, les retours, sans que ce chemin se consume dans sa fin.
Il demeure continue oscillation entre ces différents états, ces couches qui
génèrent un sentiment de réminiscence incertaine.
On peut ensuite repérer cette image-geste dans ce qu’on appelait auparavant
le «montage», moment du travail d’assemblage des images réalisées (rushes).
Sauf que sur l’ordinateur, les images ne restent plus telles qu’elles furent
enregistrées : le cinéaste reprend un mouvement filmé, le ralentit,
le duplique, le surimpose à un autre, l’agrandit. Il filme encore au moment
du montage… Il s’est approprié le laboratoire auquel on pouvait demander
certaines opérations mobilisant la chimie, le banc-titre. Vertov disait que
le montage commençait au tournage, on peut maintenant dire que le
tournage se poursuit au montage.
C’est que le numérique, dépassant la video qui offrait une texture de lignes
vouées à reproduire la ressemblance iconique, retrouve la matière. Celle de
la pellicule, le grain photographique, les sels d’argent. Ses molécules à lui,
ce sont les pixels. Et par là il se rapproche encore de la peinture, ses
pigments, ses coulures, des épaisseurs.
A condition bien sûr de ne pas asservir la technologie numérique à la
figuration du cinéma et de la télé, à l’icone analogique. A condition de
l’appréhender dans son épaisseur, sa part d’opacité, de résistance à la
«lisibilité». Plusieurs parmi les jeunes cinéastes ou artistes – souvent
des femmes – qui utilisent la caméra dv et l’ordinateur jouent de ces
potentialités, ont su en jouer : Valérie Pavia (le Jour de l’ours), Claire
Angelini (Réciprocités) par exemple, dont les travaux ont été récemment
montrés dans des galeries à Paris.
Dans cette démarche, la question de la «signature» des images ou de leur
origine se trouve relativisée : Dwoskin retravaille des super 8mm de famille,
il demande qu’on le filme sur son lit d’hôpital, il peut prendre son bien où
il veut, c’est son travail sur l’ordinateur qui compte.On voit bien le chemin
récemment parcouru quand on compare Dad et Trying to Kiss the Moon, où
apparaissaient pour la première fois ces super 8mm, mais dans une
perspective avant tout iconique. Aujourd’hui leur texture compte autant
que leurs figures.
Ces changements techniques et d’expression ont déplacé ce qui était
structurant dans le cinéma de Dwoskin, l’érotisme du regard, du point de
vue sur le sujet filmé. Certes chez lui la représentation était problématisée
à l’extrême, grâce à une écriture fondée sur l’évitement, le ratage, le
décentrement. Dans son chef d’œuvre, adaptation de Wedekind, Tod und
Teufel, il ne filme que l’espace entre les êtres, des ébauches de gestes,
le bruissement de la parole, retrouvant les «tropismes» d’une communication
impossible. Maintenant son objet, c’est l’exploration de la texture même de
l’image, le grain. Filmant Bill Brandt et ses photos (Shadows from Light),
il avait déjà approché cette dimension, mais aujourd’hui on ne se met plus
à distance : il se dégage dès lors un sensualisme diffus de ce cinéma de
la peau. Le «digital» caresse de la main, des doigts.
On s’éloigne ainsi du «3e œil», du regard délégué à l’appareil qui traquait
souvent son objet, le violentait (Moment, Dyn-Amo et surtout : Trixi).
La caméra dv, comme l’appareil photo numérique, se tient à bout de bras :
ils sont plus geste que regard, plus engagés dans le monde filmé que
spectateurs derrière l’œilleton, ou du moins ils combinent les deux moyens,
comme le préconisait Diderot dans sa «Lettre sur les aveugles».
François Albera
(retour au menu)
Je filme donc nous sommes
Si l’oeuvre cinématographique de Stephen Dwoskin est à la fois sublime et
inclassable, c’est qu’elle excède toujours les enjeux formels, poétiques ou
narratifs qui la constituent. La beauté – parfois presque insoutenable –
de ses films, la virtuosité de ses compositions de cadres, la maîtrise de
la lumière, la précision rythmique de la succession et de l’interaction des
plans, la mélodie singulière de ses bandes-sons forcent l’admiration.
Mais l’essentiel est ailleurs.
L’essentiel, c’est l’expérience – au double sens du mot francophone, à la fois
experience et experiment – dont chacune de ses œuvres rend compte et
à laquelle chacune de ses œuvres nous convie.
Je filme donc je suis pourrait en effet être le premier terme de l’équation
cinématographique de Dwoskin. Ses films - que certains ont comparés à ceux
d’un entomologiste – explorent sans complaisance et sans contraintes
morales ou esthétiques préalables l’objet de son regard. Le cinéaste ne
montre pas ce qu’il voit, il donne à voir ce qu’il découvre du monde, de soi
et de l’autre en le filmant, et que seul le geste cinématographique est à
même de révéler : le cinéma comme clé du monde.
Je te filme donc tu es, tel pourrait ainsi être le second terme d’une tentative
de définition de son œuvre. Ce n’est pas que le cinéaste ait toujours filmé des
femmes, mais aussi des hommes, qu’il a aimés, leur offrant en partage
l’expérience humaine (ici cinématographique) la plus importante à ses yeux ;
c’est plutôt qu’il a toujours aimé ceux qu’il a filmés, sa caméra instaurant
avec eux un rapport d’une intensité et d’une intimité rares.
La caméra de Dwoskin ne capte en effet rien qui lui préexiste : c’est le
rapport qu’elle instaure avec l’autre qui fait advenir les êtres et le monde
qu’elle donne à voir. Mais les deux premiers termes énoncés seraient vains
s’ils n’étaient complétés d’un troisième qui donne à l’œuvre de Dwoskin sa
véritable puissance : je filme donc nous sommes.
Le spectateur n’est en effet jamais le tiers exclu de ce rapport à soi et au
monde : c’est parce que nous le regardons regardant que les deux premiers
termes de l’équation opèrent. C’est de notre propre condition humaine, de
notre désir, de notre jouissance comme de notre douleur que ses films
rendent compte, radicalement.
Cathy Day
(retour au menu)
A propos de quatre films de Stephen Dwoskin
Dans Pain is, Dwoskin remarque : Si vous effleurez le bois avec le doigt,
vous sentez le bois ; si une écharde vous blesse, vous allez sentir votre
doigt. C’est ainsi que fonctionne la douleur. C’est aussi la manière dont
fonctionne le cinéma de Stephen Dwoskin. Ce n’est pas un cinéma lisse
que l’on peut se contenter de caresser du regard, d’effleurer de la pensée,
un cinéma dans lequel il est permis de s’oublier et d’oublier le monde.
C’est un cinéma qui blesse et qui fait exister et qui ravit et qui soigne,
un cinéma qui, comme l’écharde fait prendre conscience du doigt, nous
fait prendre conscience de notre regard.
Dwoskin est le plus souvent envisagé, de par le contexte de son arrivée
dans le monde cinématographique, comme un cinéaste expérimental – ce
qu’il est, à l’évidence, comme tout artiste véritable –, mais cela crée un
malentendu – et des difficultés de distribution de ses films – dans la mesure
où, aussitôt, on le pense – le monde est routinier et la pensée – comme
avant tout dominé par des préoccupations formelles et, de ce fait, peu
accessible à un vaste public et d’ailleurs peu soucieux de le conquérir.
Or ce n’est pas ce que dit Dwoskin. En 1981, déjà, il explique : Behindert
était destiné à un public de télévision et il était plus facile de lui faire
comprendre ce que je voulais dire en me mettant directement en scène.
Mon but est de faire des films qui marchent aussi bien au cinéma qu’à
la télévision.
Et à la question suivante : Un film de télévision est plus vu qu’un film
commercial (et a fortiori qu’un film de recherche). Comment vis-tu cette
contradiction ?, il répond : Je ne trouve pas ça fascinant. Je pense que
beaucoup de gens peuvent comprendre mes recherches. Je crois beaucoup
plus au public que les gens qui réalisent des programmes de télévision.
Propos qui peuvent paraître convenus, mais, en 2004, dans un texte qui a
paru dans le n° 50 de Trafic et intitulé Réflexions. Le moi, le monde, les
autres, comment cet ensemble se fond dans mes films, Steve Dwoskin
développe les valeurs qu’il attache à son métier de cinéaste.
Faute de pouvoir reproduire entièrement ce texte, il convient d’en livrer
quelques bribes, car il est remarquable – un texte humaniste (nous postulons
que ce mot a encore un sens) – et plus éloquent que n’importe
quel commentaire.
D’abord l’exigence de l’artiste : Le cinéma est mon langage, et sans langage,
je suis silencieux, et dans le silence, je cesse d’exister. Le silence peut tuer,
rester silencieux, c’est se fermer littéralement au sentiment d’humanité (…)
J’ai dû trouver ma voie en tant que cinéaste, maintenir un sentiment
d’humanité propre ainsi qu’un mode d’expression personnelle. (…)
Le projet : Je fais ce que je sais faire. Rien d’autre. Il s’agit de faire des films
pour me libérer et, bien sûr, pour libérer les autres, le spectateur en
particulier. C’est aussi faire des films qui explorent, qui expriment le moi.
Exprimer le moi signifie également l’exposer tout en permettant le dialogue
avec les autres. Non seulement le dialogue mais un processus d’investigation
et de réflexion pour tous, un «transfert positif» en termes lacaniens. Pour
pouvoir l’accomplir, la fabrication du film doit être honnête et révélatrice.
Il faut qu’elle porte témoignage sur le sujet, sur le moi. Qu’elle fasse en
sorte que le spectateur puisse s’engager avec son moi et ses sentiments
propres. Les films, mes films, doivent s’ouvrir à l’allusion et à l’espace
intime afin de permettre au spectateur d’y entrer et d’y réfléchir. (…)
La forme : Mes films sont fabriqués par un processus réflexif (souvent
méditatif) devenant par là même des réflecteurs. Voilà qui oblige à un type
(un style) de réalisation en dehors, au-delà des barrières du «récit»
conventionnel (au-delà même du voyeurisme). Pour ce genre de films
(qu’on qualifie souvent de «personnel»), il n’est pas de dénomination précise.
Le cinéma comme une aventure : En raison de cette absence de classification,
absence d’explication, ces films paraissent difficiles, voire menaçants pour
certains (et pour les conventions établies). L’effet miroir produit par un type
de cinéma «personnel» et «expressif» comme le mien (ou celui de quelques
autres) présente une image infinie de la vie (…)
Considérons que l’expérience de faire (ou voir) un film «personnel» (ou un
film sans frontières) est une sorte de voyage en pays inconnu – en un lieu
où nous ne sommes jamais allés –, une histoire d’amour avec quelqu’un
nous demandant des choses que nous n’avons jamais faites. Cela devient
une aventure, un processus révélateur de l’identité propre. Cela insiste sur
le fait que le spectateur doit travailler et regarder. (…)
Ce genre de films, mon genre de films, va chercher assez loin pour voir non
seulement le beau mais le terrible; les choses apparemment repoussantes
qui existent, sont communes à tous les êtres et ont une valeur.
Toute glose de ces extraits serait vaine – on peut noter la rigueur et la densité
de la langue, donc de la pensée. Mais ils permettront, c’est notre espoir, de
vivre plus intensément l’aventure des quatre films dont il va être question
(et de l’ensemble des films de ce coffret). Ils permettent aussi de lever le
soupçon de voyeurisme (on a même parlé de scoptophilie [ ? !]) ou
d’exhibitionnisme – donc de gratuité – trop souvent développé à l’égard de
certains films de Dwoskin. Il permettent enfin de «relativiser» des propos
du genre : Si le travail qu’a accompli là Stephen Dwoskin est remarquable
et méritoire, il n’en demeure pas moins assez imparfait techniquement.
A film is like a battleground, love, hate, action, violence and death, in one
word : emotion. C’est, bien sûr la manière dont Samuel Fuller définit le
cinéma pour Pierrot-Ferdinand.
Dans Behindert (1974), Outside in (1981), Pain is (1997), Intoxicated by
my illness (2000), les champs de bataille que choisit Steve Dwoskin sont
ceux de la paralysie et de l’amour, de la maladie et de la mort, de la
souffrance et du plaisir, de la violence des choses et de la douceur des
femmes. Et, contrairement à beaucoup d’officiers supérieurs, il n’hésite
pas à payer de sa personne.
C’est dans Behindert que Dwoskin se met en scène pour la première fois,
tout simplement, dit-il, parce que c’est sa propre histoire qu’il raconte.
Une histoire simple : un homme et une femme – que des titres de
films – se rencontrent au cours d’une soirée entre amis, ils se revoient,
vivent ensemble quelque temps, puis la femme s’en va.
Émotion, disions-nous : la séquence de la rencontre dure une quinzaine
de minutes, quinze minutes de regards de Carola, femme qui regarde,
femme qui est regardée – par la caméra, le personnage Steve n’apparaît
jamais dans cette première partie du film, il reste l’homme-caméra de
ses autres films –, femme en représentation, femme saisie dans son
intimité intérieure. Il nous semble que jamais les attentes interrogatives,
les frémissements de la sensibilité, la curiosité fiévreuse, l’angoisse vague
qui accompagnent une première rencontre amoureuse n’ont été mieux
montrés. La suite est aussi jubilatoire et déchirante. Le cinéaste nous
demande de regarder des choses que nous n’avons jamais regardées et il
nous raconte une histoire d’amour qui peine à se frayer un passage dans
les aléas du quotidien – d’un quotidien handicapé – et qui s’y enlisera.
La question fiction-réalité n’a pas grand sens si l’on admet que ce qui est
réel n’a pas besoin d’être regardé pour exister.
Note en passant
Les plans sont brefs, le montage saccadé, la prise de vue «tremblée».
Le malaise est visiblement voulu. Autrement dit, la technique – très voisine
de celle du cinéma d’amateur – se réclame de l’avant-garde. C’est donc un
effet de l’art, un parti pris, écrit Stanislas Gregeois à propos de Behindert
dans Télérama en 1977.
Nous ne reviendrons pas sur des considérations techniques puisque nous
n’avons pas la prétention – ni les moyens – de faire un travail d’analyse.
Mais que dirait-on si des considérations de ce genre étaient développées
à propos de Céline, par exemple : Les phrases sont maladroites, la syntaxe
tremblée, le vocabulaire approximatif. (…) Autrement dit, la technique – très
voisine de celle d’un écrivain amateur etc. Quel tort ont pu causer aux films
de Dwoskin – qui sont aussi bouleversants que des films de Ford ou de Chaplin
(ad libitum) – des propos de cette encre ? C’est parce qu’ils sont «écrits»
comme ils le sont que les films de Dwoskin sont bouleversants. Ce sont les
jambes de Dwoskin qui sont paralysées, pas ses capacités techniques, ni son
énergie créatrice.
Avec Outside in, Dwoskin nous offre un film que nous serions tenté de qualifier
de picaresque. Un roman picaresque est une confession imaginaire. Le picaro
fait à la première personne du singulier le récit de «ses fortunes et
adversités» (…) Aux images stylisées du chevalier ou du berger arcadien
(les productions cinématographiques «courantes» ?), le picaro prétend
substituer une stylisation narquoise de l’expérience quotidienne dont il ne
retient à dessein que ce qu’elle peut présenter de plus dérisoire.
En général, l’expérience quotidienne ainsi conçue ne saurait être objet de
littérature (ou de cinéma).
Steve (le personnage) se retrouve dans des situations étranges, est confronté
à des personnages bizarres (ou qui deviennent bizarres du fait de leur
rencontre avec Steve justement). Se succèdent farces et aventures avec
des femmes, bien sûr, mais aussi avec des hommes et, en particulier avec
deux ivrognes qui se sont mis dans la tête que Steve avait besoin d’être aidé.
Il est peut-être temps de parler de l’utilisation du comique par Dwoskin :
Outside in est un film qui parle du handicap, c’est un film qui est drôle aussi,
voire burlesque. Seul, évidemment, un handicapé peut utiliser ce mode
pour se mettre en scène comme personnage handicapé.
Bergson affirme, d’une part, que peut devenir comique toute difformité
qu’une personne bien conformée arriverait à contrefaire (p. 18) et, d’autre
part, que nous aurons surtout une impression de comique quand on nous
montrera l’âme taquinée par les besoins du corps, – d’un côté la personnalité
morale avec son énergie intelligemment variée, de l’autre le corps stupidement
monotone, interrompant et intervenant avec son obstination de machine.
Plus ces exigences du corps seront mesquines et uniformément répétées,
plus l’effet sera saisissant. (pp. 38-39)
Stephen Dwoskin choisit donc de montrer le corps de son personnage Steve
comme un corps potentiellement comique et il n’hésite pas en jouer, soit
classiquement (final «apocalyptique» du film où on le voit entraîner dans
sa chute une cuvette de W.C. que, rigolard et ruisselant, il enlace), soit de
manière plus dialectique (la séquence – digne de Buster Keaton – au cours
de laquelle il rencontre un éditeur qui veut à toute force qu’il s’assoie sur
une chaise pivotante… pour simplifier leur entrevue. Comme celui de Keaton,
le visage de Steve reste impassible). Le comique peut aussi venir de
l’opposition du texte off et de l’image (comme dans les séquences répétées
où Steve essaie de rejoindre une femme étendue sur un lit, séquences
répétées mais aux infinies et subtiles variations de cadre, de vêtements,
de plans, de lumière). Il faut encore peut-être, surtout – évoquer cette
séquence dans laquelle une femme vêtue seulement d’une petite culotte
équipe ses jambes – comme s’équipe un écuyer – des appareils
orthopédiques de Steve et se mesure à la difficulté que présente dès
lors chaque mouvement. Á ce moment nous sommes dans la situation
décrite par Bergson : elle rit et Steve rit, mais qu’en et-il du spectateur ?
Est-ce qu’il rit ? Il faut bien, dit Bergson, qu’il y ait dans la cause du
comique quelque chose de légèrement attentatoire (et de spécifiquement
attentatoire) à la vie sociale, puisque la société y répond par un geste qui
a tout l’air d’une réaction défensive, par un geste qui fait légèrement
peur (p. 157). Est-ce ce que voulait dire Stephen Dwoskin quand il craignait
que ses films devinssent menaçants pour certains. D’autant que l’on pourrait,
sans trop – nous semble-t-il – solliciter le sens, traduire Outside in par Mon
cœur mis à nu.
Une des dernières séquences – en noir et blanc – de Pain is montre un
spectacle de clown : une corde est tendue et le clown veut y accéder, il
perd plusieurs fois l’équilibre, tombe, se relève, recommence et,
finalement, se révèle un merveilleux danseur de corde. Une métaphore
de Dwoskin comme cinéaste ? C’est ce que nous pouvons y voir, ce que
nous y voyons aussi.
Il dit, lui, dans Pain is, La comédie semble refléter la structure d’une douleur,
ce déplacement de l’affliction vers la disparition. Il dit encore : Est-ce
l’absence de douleur dans une situation qui semble douloureuse qui nous
fait rire ? Le rire est un grand réducteur de douleur.
Dwoskin ne pourra jamais contrefaire l’homme qui marche et s’il connaît à
merveille les lois «mécaniques» du comique, il les plaque non sur du vivant,
comme le voulait Bergson, mais sur du vécu. Et c’est sublime.
Nous reviennent en mémoire ces deux vers d’un grand mélancolique, Musset,
qui s’était trouvé presque seul, un soir, au théâtre français, car on n’y jouait…
que Molière et qui, à propos du comique de celui-ci, écrit :
Quelle mâle gaîté si triste et si profonde
Que, lorsqu’on vient d’en rire, on devrait en pleurer.
Pain is est un «documentaire» réalisé pour Arte en vue d’une soirée
thématique sur le thème suivant : Qu’est-ce que la douleur ? Nous avons
dit documentaire alors qu’il eût fallu parler de réflexion, voire de méditation.
Le projet est relativement classique dans la mesure où il s’agit d’une suite
de prises de parole, mais c’est Dwoskin qui dit le commentaire – une voix
chaude, attentive, modeste – c’est lui qui mène les entretiens, c’est lui qui
problématise (il parle bien d’une quête personnelle, le sujet de tous ses films,
en somme).
Peut-on élaborer une image de la douleur ? Comment perçoit-on la douleur et
comment l’exprime-t-on ? La douleur nous affecte si profondément que nous
sommes obligés de lui donner un sens, dit-il (la substance de son travail).
Il est surtout question de maladies physiques, psychologiques ou morales,
mais ne sont pas omises les douleurs délicieuses – ces étranges frontières
communes de la souffrance et de la jouissance (un autre thème récurrent de
son œuvre), l’érotique de la douleur ou la douleur érotisée (et il se prête
lui-même aux expériences nécessaires) –, la douleur du sportif arrachant sa
fonte ou encaissant des coups, les douleurs extasiées de la religion.
Le film est beau et dense parce qu’il est le reflet du regard de Dwoskin,
parce qu’il est l’écho de ses angoisses et de son quotidien, parce qu’il donne
non à voir mais à regarder et à méditer. On peut, paraît-il, s’arranger de sa
douleur – souvent pour se libérer de la douleur, il faut plonger dans la
douleur – Comment appelleriez vous votre douleur, demande Dwoskin à un
jeune homme, les Anciens l’appelaient chien ? – Je l’appellerais la vie,
répond le jeune homme. La vie pour laquelle on se bat (encore un champ
de bataille) derrière les murs des couloirs interminables d’un hôpital que
Dwoskin parcourt en longs travellings fiévreux ou apaisés.
Et il y a ces plans récurrents d’arbres agités par le vent… Extérieur jour
pour respirer ? Métaphore de la condition humaine (mais l’homme est plutôt
un roseau) ? Hommage au physiologiste Marey qui, grâce au cinématographe,
a décomposé, entre autres, le mouvement d’un homme qui marche, mais
a aussi filmé la fumée ou les feuilles qui tombent ? Hommage au cinéma
qui a permis la reproduction du mouvement et donc de la durée et,
subsidiairement, de la vie et de sa fin?
Intoxicated by my illness nous parle de la fin proche, de la limite. Mais c’est
comme si nous disions que, par exemple, Rigoletto nous parle de la paternité
(le sujet est à la mode cette année). Bien sûr, il est question de paternité
dans Rigoletto et Rigoletto est intoxiqué par sa paternité. Mais vous
reconnaîtrez qu’en disant cela, nous ne disons rien de Rigoletto. Eh bien,
Intoxicated est un film opéra avec une partie pour barytons et soprani et
une partie pour ténors et mezzo-soprani, la lutte entre frères ou sœurs ou
frères et sœurs, ennemis, mais superficiellement puisqu’ils sont frères
et soeurs.
Un travail voluptueux sur l’image comme une musique avec élaboration
contrapunctique, chant et contre chant – non, pas champ et contre champ,
nous ne sommes pas au cinéma.
L’antichambre de la mort, les couloirs parcourus de l’hôpital Saint-Thomas
encore, la chambre des urgences, comme une salle de torture avec ses
instruments bizarres qui aident paradoxalement à vivre, des femmes en
blanc qui se penchent sur des hommes qui souffrent, qui respirent mal,
qui meurent – un malade au visage de momie longuement scruté avec un
drain comme une fleur rose et jaune qui jaillit de son cou. Ces femmes
en blanc ont des gestes délicats et sûrs, elles savent comment soulager
et parfois elles tourmentent pour soulager. Leur croupe – nous employons
ce mot car il est exigé par l’image – leur croupe cependant est suivieavec
insistance par un homme, de ceux qui respirent mal et souffrent et meurent,
un homme qui rêve, éveillé peut-être, c’est Steve. Et nous voilà au
Venusberg, les femmes sont en noir, les hommes sont toujours allongés nus,
enchaînés, ligotés, suspendus, les femmes en noir ont des gestes délicats et
sûrs, elles savent comment les soulager, comment les tourmenter pour les
soulager. Et le rythme s’accélère et, bientôt, les deux univers se mêlent,
se superposent, se repoussent et s’attirent. Les femmes deviennent
interchangeables, les en noir et les en blanc. On ne sait plus qui souffre
et qui jouit. Et si la mort ?
Au fond, nous n’avons voulu dire qu’une chose, même s’il nous a fallu du
temps pour la dire : Stephen Dwoskin est un cinéaste infiniment plus
important que Steven Spielberg et il est tout aussi infiniment regrettable
que la diffusion de leur travail ne soit pas le contraire de ce qu’elle est.
Mais, bon, là, maintenant, tout le monde a l’air de trouver cela normal.
Michel Barthelemy
(retour au menu)